
Interview Bertrand Coty
Patrick Mardellat, vous publiez aux éditions Hermann, Économie Radicale. Comment définissez-vous la radicalité dans le domaine économique ?
Le terme de radical présent dans le titre désigne effectivement une radicalité qui court dans tout l’ouvrage et qui peut s’entendre en plusieurs sens. Économie radicale veut tout d’abord dire que l’économie est radicale, qu’elle est à la racine de la vie, car toute vie commence par être économique, qu’elle s’inscrit dans une économie. Cela s’exprime de plusieurs manières, par le fait tout d’abord que nous nous recevons dans un don avec la vie et que nous sommes accueillis dans une communauté qui est toujours d’abord une communauté économique, qui offre un foyer ou un lieu de vie ; ensuite, la vie se manifeste à nous immédiatement par des besoins ou une demande, de soins, de protection, de nourriture, et plus fondamentalement encore, ce qui d’ailleurs constitue le fond de tout désir de vivre, une demande d’amour, plus profonde encore que la demande de justice. Et à une telle demande, seul un don peut répondre, un don inconditionnel, sans retour, sans dette.
Ce qui fait du don l’acte premier, absolu, de toute économie. Tous les autres actes économiques, que la théorie lie entre eux de manière systématique, tels que la production, l’échange, le prêt, le partage, etc., viennent ensuite du don premier. Une vie terrestre ne peut se concevoir en dehors de l’économie et toute vie ne peut se déployer qu’à partir et à l’intérieur d’une économie. C’est là un premier sens de la radicalité, qui pointe vers la radicalité du domaine économique, plus que dans le domaine économique.
En faisant du don le premier moment de l’économie, la signification des notions essentielles de l’économie, telles que la richesse et la pauvreté, s’en trouve totalement renouvelée, et l’ordre des catégories de l’économie est bouleversé. C’est là un deuxième sens de la radicalité en économie, qui invite à déconstruire l’histoire de la pensée économique contemporaine, qui n’est que l’histoire de la théorisation d’un « capitalisme utopique », qui ne tient pas conceptuellement.
La science moderne de l’économie s’est bâtie sur une fiction, selon laquelle ce monde serait inhospitalier aux hommes, et qu’ils seraient condamnés à se livrer une guerre permanente pour lutter contre la rareté, que les autres constitueraient une menace et qu’il conviendrait de mâter la nature pour se tirer de la pauvreté et atteindre une prospérité de masse. Ce n’est là qu’un récit que les économistes nous ont demandé de croire, et que nos sociétés ont accepté de croire, nous entrainant sur la voie qui nous a conduits là où nous en sommes de notre rapport à la nature, au monde et aux autres.
Non seulement nous nous rendons compte aujourd’hui que le récit était faux et qu’il nous a précipités au bord de l’abîme où nous nous trouvons (guerres perpétuelles, catastrophes écologiques en cascade), mais nous le savions en nous-même, car nous éprouvions et éprouvons au quotidien dans notre vie économique qu’il n’en va pas ainsi : nous ne sommes pas en guerre les uns contre les autres, nous ne cherchons pas à maximiser notre gain sur le dos des autres, nous n’agissons pas systématiquement de manière égoïste, nous ne sommes pas utilitariste en chacun de nos choix, etc., mais nous voulons être juste, nous valorisons la générosité et la bonté, nous savons ce que la nature nous donne, la terre, le ciel, les milieux, et les autres nous sont une richesse indispensable.
Tout cela dessine une autre économie, qui n’est pas illusoire, qui n’est pas fausse illusion, qui n’a pas non plus disparu sous les avancées du capitalisme, mais qui est toujours bien là, présente, sous-jacente à la dureté des rapports marchands, et qui constitue d’ailleurs une importante source de résistance et d’inspiration pour des solutions alternatives qui surgissent de manière anarchique comme des événements, qui constituent autant de trouées lumineuses qui nourrissent l’espérance qui entretient le désir de vivre. C’est là un troisième sens de la radicalité qui fait signe en direction d’une économie plus profonde, en deçà de l’économie facticielle dont la science économique, se rendant la tâche trop facile, fait la science.
Ces trois sens de la radicalité sont bien entendu intimement liés dans Économie radicale, de la méthode employée jusque dans les résultats.
Vous exprimez le fait que « que les croyances véhiculées par la pensée économique ignorent le sens de ce que nous vivons quand nous accomplissons des actes économiques », qu’est-ce que cela implique ?
Ces croyances véhiculées par la pensée économique trouvent leur origine dans la fiction que j’ai évoquée précédemment, à savoir que nous sommes en lutte, que la nature est avare et mauvaise, que dans notre condition originelle nous sommes pauvres et que c’est là un malheur auquel nous pouvons échapper, en étant toujours plus rationnels, calculateurs, utilitaristes, égoïstes, etc., que le salut terrestre est dans la production et l’accumulation croissante.
Ces croyances forment le noyau de l’économie politique, que nous appelons aujourd’hui science économique. Or, ce n’est pas là le sens qui est perçu dans nos vécus économiques lorsque nous accomplissons nos actes économiques, dans la consommation, l’échange, le partage, le travail, le prêt et le don. Nous ne sommes pas face à des grandeurs et des quantités que nous maximisons, mais en chacun de ces actes nous vivons, avec nos passions, nos émotions, nos sentiments, et surtout notre désir, qui est un désir de bien. Nous cherchons à bien vivre, donc bien consommer, bien travailler, à être bons dans l’échange, justes dans nos rapports aux autres.
Ce sont là des vertus. Ce n’est pas parce que les économistes les ont expulsées de leur vocabulaire qu’elles ont disparu. Et ce n’est pas parce qu’il est difficile d’être vertueux que nous ne cherchons pas à l’être, même sans nécessairement en avoir la connaissance théorique. Que les croyances que véhiculent la pensée économique ignorent ce sens que nous prêtons à nos actes économiques implique d’abord que nous ne nous reconnaissons pas dans les discours économiques, que nous en sommes absents, remplacés que nous y sommes par des machines de calcul au comportement stéréotypé ; cela implique également que ces discours nous induisent en erreur et nous font courir après une fausse richesse, dont on voit l’effet individuel et surtout collectif désastreux dans l’état de notre monde ; cela implique enfin un profond désenchantement et même un malheur : désenchantement qui n’est pas un déniaisement de nos illusions par des connaissances scientifiques validées, mais désenchantement parce que le monde qui en résulte paraît de plus en plus sombre, ce dont nous souffrons.
Or, nous savons qu’il y a une autre économie, et qu’elle n’est pas perdue, mais qu’elle est là et vit souterrainement en nous, continuant de nous animer et orienter dans nos actes économiques.
Comment combler les écarts qui se creusent, l’incompréhension qui s’exprime, entre l’économie réelle et théorique ?
C’est une question à laquelle il est difficile de répondre, car elle ne se comprend pas seulement au sens théorique, mais a une portée pratique. Sur le plan théorique, la déconstruction, ou plus simplement la critique qui est menée dans le livre nous délivre de l’emprise du discours de la science économique et prépare le terrain pour une conversion, conversion intérieure et conversion du regard. C’est à cela que conduit toute entreprise philosophique, à un dévoilement des fausses évidences, et à une révélation de la réalité. La réalité n’est pas celle du capitalisme, ce qui ne revient pas à nier que le capitalisme n’est pas la cause de l’exploitation de l’homme par l’homme et de la nature par l’homme, cause des catastrophes et de la crise de l’humanité, mais ce qui veut dire que cette réalité catastrophique du capitalisme n’est pas la réalité profonde de l’économie et d’une économie humaine.
Non seulement une autre économie existe et est réelle, c’est-à-dire se trouve recouverte par le capitalisme, une économie plus profonde donc, mais aussi plus réelle en ce que nous en éprouvons le sens et la vérité au plus profond de notre vécu. C’est là le plan pratique auquel se vit l’économie. C’est de cette économie que surgissent par événements des échappées hors des rets du capitalisme dont les mailles laissent traverser des expériences subversives, comme les communs, les monnaies complémentaires, etc., mais aussi plus simplement dans les relations économiques de proximité où ceux qui se rencontrent, qui travaillent ensemble, échangent, se prêtent et s’entraident, etc., se rencontrent comme des prochains les uns pour les autres, où chacun est une adresse, un appel à l’autre, qui s’entend et auquel une réponse est donnée.
C’est cela qui constitue la réalité de l’économie, mais pas les balances et comptes extérieurs, les équations d’équilibre macroéconomique, les indicateurs, indices, taux et autres mesures exprimées de manière homogène à des lieues au-dessus du vécu économique de ceux qui forment des communautés économiques vivantes. Ces écarts qui se creusent sont presque naturellement comblés par les acteurs eux-mêmes dans les interstices du capitalisme et du marché, qui ne parvient pas à former la toile complète de l’économie.
Cette situation n’est-elle pas en grande partie le germe du doute et du désengagement (voir du rejet) politique de nos concitoyens ?
Si l’on considère que le discours de la science économique n’a pu s’imposer que parce qu’il a été encouragé par l’État moderne, celui qui a été théorisé par Hobbes, alors, oui, le refus aujourd’hui de ce discours et le fait que nous n’y croyons plus et ne voulons plus y croire, entraine de fait avec lui une défiance dans l’État et la politique telle qu’elle a été conduite depuis trois siècles, à savoir une gouvernementalité qui indexe tout à des performances économiques, constituant une sorte de continuation de la guerre par d’autres moyens (guerre aux autres, mais surtout guerre à la nature).
Cela ne veut pas dire un désengagement politique de nos concitoyens, cela veut plutôt dire un refus de participer à ce qui apparaît comme une grande mascarade – à l’enterrement de la sardine dans la représentation qu’en donne Goya, si l’on veut – pour inventer ou retrouver une autre forme de politique, trouver d’autres formes politiques, qui dans l’étape actuelle de cette histoire se cherche dans de nouvelles formes d’engagement.
C’est le désengagement de la participation que nous voyons et que les politiques et chroniqueurs veulent voir, pour le dénoncer, mais cela ne doit pas faire oublier l’engagement innovant, qui est une réappropriation du politique, par l’économique. Cela est très intéressant, car cela montre que la politique n’est pas séparée de l’économique, et que c’est à partir de nouvelles formes économiques que l’on peut parvenir à retrouver le sens authentique du politique.
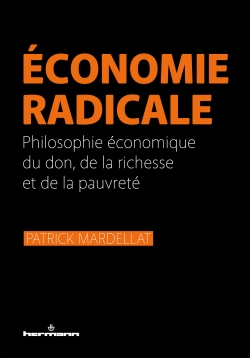
Production BCC – Tous droits réservés 2024

Patrick Mardellat est Professeur des Universités en science économique à Sciences Po Lille et chercheur au Centre Lillois d’Études et de Recherches en Sociologie et Économie (CLERSE). Il est directeur des Cahiers d’Économie Politique depuis 2015. Ses travaux portent sur la philosophie économique et l’histoire de la pensée économique. Il s’intéresse aux questions de richesse et de pauvreté, de travail et plus généralement d’éthique économique autour du don et du bonheur. Il a publié de nombreux articles dans différentes revues académiques sur ces différents thèmes.

